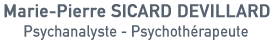Joyce Mac Dougall : une lecture soutenante
C’est en participant à un groupe de travail centré sur la lecture des textes de Joyce McDougall, que j’ai « rencontrée » cette grande dame de la psychanalyse. En effet, lorsque je suis venue, ou plutôt revenue, sur la scène psychanalytique, après qu’elle s’en soit retirée, il n’était plus envisageable de faire une supervision avec elle par exemple, ni de courir à ses apparitions publiques.
Cependant, grâce à cette lecture commune, l’oeuvre de Joyce McDougall m’est devenue familière, et elle-même, comme une personne de référence qui accompagne ma pratique.
Sa vivacité d’esprit, sa présence, sans doute, dans son engagement avec ses patients, demeurent, et perlent au creux de ses écrits, écrits qui agissent comme autant de traits d’union, de sollicitations, à interroger le « je ».
A l’occasion du colloque organisé par la clinique de Saumery, en juin 2013, proposition fut faite au groupe de formaliser ce que la lecture avait mobilisé en nous, lectrices, du côté de notre subjectivité et notre pratique d’analystes. En réponse à cette invitation, un travail de pensée s’est mis en marche, presque à mon insu, à l’instar de ce qui se produit à un moment ou un autre de la cure. Sont venus se former des liens, des associations, jusqu’à me conduire à trouver une posture, un tour de main, particulier avec une patiente.
Joyce nous dit dans son introduction aux « Théâtres du corps » que la subjectivité entre en scène dès la formulation d’une demande d’analyse, elle ne peut pas ne pas être là, elle est une condition de l’analyse.
En face, et c’est ce que je questionnerai ici : la subjectivité de l’analyste.
Si la cure est ce qui permet de conduire l’analysant à cette capacité de dire je, il ne peut en être autrement de la part de l’analyste. Celui-ci se doit de dire je.
Un premier lien se tisse alors que j’assiste à un séminaire clinique « fin d’analyse, fin de transfert ? ». La psychanalyste, qui conduit la séance ce soir-là, introduit son propos en faisant référence à trois (re)lectures qui ont nourri sa réflexion. Parmi ces trois lectures, l’article de Joyce McDougall « L’anti-analysant en analyse ». La coïncidence ne serait-elle que fortuite ? quand on parle de subjectivité….
Comment, face à des patients qui sont dans un défaut d’altérité, qui dénient notre subjectivité, travailler avec ladite subjectivité ?
Comment explorer nos contre-transferts face à des analysants qui ne sont pas avec nous, qui nous font souffrir quand nous sommes enlisés dans des analyses qui sont des épreuves.
Mais moi aussi j’ai une patiente qui me fait souffrir, depuis longtemps ! Elle ne s’y met pas et je désespère un jour de voir s’enclencher le travail. Elle me met à l’épreuve. Serait-elle une anti-analysante type ?
Alors, après tout, pourquoi ne pas lui dire à cette Valentine que je me sens dans une impasse avec elle, que ça n’avance pas et que ce n’est peut-être pas la psychanalyse qui est faite pour elle ?
Au moins si je ne la vois plus, si elle ne vient plus, je ne souffrirais plus, me dis-je en mon for intérieur.
J’en parle à un collègue de mon entourage, et lance, autant par provocation que par découragement : « je n’en peux plus, je vais la virer !». Tu n’as pas le droit, m’entends-je répondre. Non ça ce n’est pas une position qu’aurait tenu Joyce. Elle ne m’aurait pas dit ça.
Je continue de penser. Et de penser que je peux lâcher ma Valentine. Lâcher, c’est bien ce dont il est question mais que lâcher, en dehors de Valentine ?
Se réunit quelques jours plus tard un groupe de travail auquel je participe dont le thème est « corps et pensée ». Dans ce groupe un jeune professeur de philosophie dont les travaux ont porté sur l’engagement du corps au travail. Ça me parle plus que d’habitude, et même ça résonne. Il est tellement question de mon corps de psychanalyste au cœur de cette affaire de subjectivité. Et là survient une phrase de mon collègue philosophe : Le texte est un « corps » qui nous entraine dans un mouvement de pensée. Il est possible de se laisser toucher par le texte au point de se laisser emporter…
Les textes de Joyce sur lesquels je travaille, une matière vivante, dans un corps à corps.
Je relis avec attention « l’anti-analysant en analyse ». Les mots de Joyce McDougall me parle de Valentine. Tout est là, c’est la clé, elle me donne la clé, à moi de m’en saisir, de savoir ouvrir la serrure, et surtout d’oser m’en servir…
Qui plus est dans cet article, le style est si vivant, si oral, si proche, comme si elle était là qui s’adresse à nous…
Que me dit cet article :
D’abord comprendre que certains patients ne peuvent pas laisser se former les liens qui font qu’une psychanalyse devient une expérience de mutation. Ils font en quelque sorte une anti-analyse, une activité qui ne s’aperçoit pas, ou plutôt qui est observable par son absence, et qui représente une force statique, négative, d’anti-liaison, en même temps qu’elle maintient en place tout ce qui est clivé, morcelé, engouffré.
Il y manque tous les liens. Cela devient comme une analyse en inversé, en négatif, avec la difficulté de devoir saisir tout ce qui n’est pas là, ce qui ne se passe pas.
Il ne reste que le contre-transfert, à observer, nous faire observateur de ce que nous ressentons face à de tels patients.
Dans la première vignette clinique, Joyce McDougall s’implique devant son lecteur dans l’observation de son contre-transfert : les lignes de l’article que je suis en train de lire, elle « avoue » les avoir écrites en écoutant un patient de ce type, un patient robot comme elle dit, Monsieur X, qui la fait souffrir, l’ennuie, avec sa plainte alanguie qui ne mène à rien. Qui lui raconte une histoire de placard et d’interaction avec sa femme pour une histoire de placard, se plaignant du manque d’intérêt de celle-ci. Tout comme Joyce McDougall s’en fiche aussi de cette histoire de placard. A la différence, écrit-elle, qu’elle se sent coupable de son désintérêt pour son analysant.
Le risque est de désinvestir la scène analytique, l’analyste se retirant de ladite scène…
Pourquoi ?
Joyce McDougall s’interroge sur ce qui les a conduit tous deux, elle et le patient, surtout elle, à en arriver à cette non analyse ? Elle s’est laissée prendre.
Alors que faire de ces patients qui ne sont pas en contact avec eux-mêmes, qui sont en dehors des liens, qui sont dans un désaveu de l’altérité psychique ?
« L’inertie se fait sentir tardivement dans la stagnation du processus analytique ». Que faire, que proposer, face au néant dans lequel tombent les interprétations de tous ordres, les associations, les liens… L’analyste s’épuise, devient inerte. « Son insistance et sa détermination à continuer d’être analyste, à écouter, à s’identifier, à interpréter – et finalement à s’efforcer de trouver « des trucs » pour mettre en circulation le mouvement analytique – arriveront (et pour cause) à être ressenties par l’analysant comme une persécution. » [1]
Pourquoi est-ce que cela fait autant souffrir l’analyste, se demande-t-elle ?
Il s’agit bien plus qu’une simple résistance, qu’une simple affaire de clivage… « l’analyste ne peut s’empêcher de subir de façon introjective ce qui a été subi par son patient… Devant l’analysant robot, insensible à sa propre douleur, l’analyste ne peut pas s’empêcher de lui dire qu’il se laisse mourir pour une cause inconnue. Cette lutte à armes inégales avec la mort donne au vécu contre-transférentiel une dimension insupportable, et contre laquelle l’analyste cherche à se protéger. Il est insuffisant de dire d’un tel patient, avec un petit haussement d’épaules, que c’est là son problème ; que nous le voulions ou non, c’est aussi le notre. » note[2]
L’anti analysant a la rage, la hargne, il est constamment en colère, constamment dans la plainte, c’est la seule chose qui lui reste quand tout désir est fui puisque mortifère.
Joyce McDougall est pessimiste, qui se demande si nous sommes en droit de tenter d’interpréter cette hargne si précieuse. Et si l’anti analysant n’aura pas toujours le dernier mot : « dans l’analyse, ils finissent par enlever de nous, comme d’eux-mêmes, la curiosité, le désir d’en savoir plus ». Rester avec son objet de haine, ne jamais aller voir du côté de sa douleur inavouable, parce qu’inavoué, et nous demander à nous, analystes, de garder notre souffrance pour nous-mêmes. Chacun pour soi, sans que rien ne bouge, ce serait la réussite du projet « analytique » de l’anti-analysant.
S’en tiendrait-elle à ce constat pessimiste et décourageant et n’aurais-je pas de réponse à mette en œuvre face à mon insupportable Valentine ?…
Non, c’est une combattante. Ainsi le dernier paragraphe de son article :
« Pourtant cette réponse ne saurait nous satisfaire. Malgré tout ces analysants tiennent à leur aventure analytique, tiennent à montrer à leur analyste combien il est inefficace (bingo !). A titre hypothétique je suggèrerai que ces patients s’accrochent à la relation analytique comme un noyé à une bouée de sauvetage, sans aucun espoir de gagner la terre. A quoi s’accrochent-ils donc ? Je crois que dans la situation analytique ils trouvent la confirmation que l’inconscient, qu’une autre scène, et qu’une autre façon d’exister sont pensables. Du moins leur analyste le croit. » note[3]
Je referme le livre, c’est lumineux, comme en écho au titre du livre de Philippe Porret « Joyce McDougall, une écoute lumineuse ». Et une évidence s’impose à moi s’agissant de Valentine. Ce n’est pas Valentine que je vais lâcher c’est ma position d’analyste. Si être psychanalyste avec Valentine me fait autant souffrir et ne fait rien bouger, je ne « ferai plus la psychanalyste », je ferai autre chose.
Ma patiente arrive avec sa plainte habituelle, ritournelle, rituelle, le travail auquel elle n’a pas envie de se mettre qu’elle m’explique encore : un tel est impossible, un autre lui a fait un mauvais coup, et les difficultés que pose le dossier en cours et son dos qui la fait souffrir. Habituellement j’écoute à demi, je suggère un improbable lien de temps à autre… cette fois, je deviens plus active. Je suis là dans le concret, dans la matière même de son travail : par quoi doit-elle commencer pour avancer dans son dossier ? quels sont les tâches les plus urgentes ? Et son dos ? comment peut-elle s’y prendre pour trouver un soulagement ? les médicaments qui lui ont été prescrits sont-ils la seule solution ? n’a-t-elle pas d’autres alternatives ?
Je m’implique, un peu comme le ferait un conseiller, un coach.
La séance se passe sur ce mode. C’est la veille du week-end, Valentine repart avec une forme de programme en tête.
La semaine suivante, Valentine revient avec une initiative, elle a décidé quelque chose pour elle-même et par elle-même. Pour une fois elle a su dire « je ».
Puis, quelques séances après que je me sois décalée de ma posture de psychanalyste, Valentine, pour la première fois de la cure, fait une incursion dans sa propre subjectivité, comprend d’elle-même qu’une crainte qu’elle éprouve actuellement est pur fantasme, sans fondement sur le réel mais sur sa propre réalité psychique.
Comme si elle pouvait enfin, elle aussi, se décaler, ne plus coller à la seule réalité opératoire.
Il me semble qu’un geste se dessine, un mouvement léger et ténu. Ça remue, ça se réveille un peu. Il m’appartient, me semble-t-il, de ne pas étouffer cette ébauche, au contraire l’accueillir, lui offrir un espace où se déployer. C’est fragile. Je n’ai aucune assurance quant à son destin. Mais aurais-je su, avec autant d’assurance, oser cette autre manière de faire, cette invention pour Valentine, si la lecture de Joyce ne m’y avait autorisé ? Je ne peux pas répondre à cette question ainsi mais ce qui m’apparaît c’est le coup d’accélérateur, l’invitation largement ouverte que j’ai puisé dans le texte, comme si c’était le mien, en toute subjectivité.
Juin 2013